En février 1915, le magazine Nation avait publié un essai en deux parties, « Democracy versus the Melting Pot : A Study of American Nationality », par Horace Kallen, alors professeur de philosophie à l’Université du Wisconsin à Madison. Dans une attaque frontale contre le mouvement d’américanisation, Kallen soutient que ce dernier n’encourage pas la fusion de nombreuses cultures mais la prédominance d’une seule. Les juifs, les Slaves, les Polonais, les Français, les Allemands, les Hindous, les Scandinaves et ainsi de suite » étaient censés être transformés par « le miracle de l’assimilation » en des êtres semblables par leur origine, leurs traditions, leurs perspectives et leur esprit aux descendants des colons britanniques, la souche anglo-saxonne ». Les Anglo-Américains, sous leur apparence d’uraméricains, ont présumé régner par droit de « primogéniture culturelle. » Les premiers immigrants, par le hasard d’être les premiers, étaient devenus une aristocratie, partisans « de la fierté du sang ». Cette attitude n’était pas seulement antidémocratique, mais aussi autoritaire, car la résistance des ethnies subordonnées était combattue par des mesures coercitives comme le système scolaire public anglo-supremaciste, qui tentait d’éradiquer les habitudes du vieux pays en écrasant l’esprit des élèves immigrés.
Pourquoi les américanisateurs ont-ils agi ainsi ? Dans une certaine mesure, c’était une simple question d’intérêt personnel ; de nombreux avantages revenaient au fils aîné dans une culture patriarcale. Mais Kallen pense que la justification reposait également sur une confusion quant à la relation entre l’État et la société civile. Les Anglo-Américains supposaient que la survie de la nation dépendait de l’uniformité culturelle, comme c’était le cas dans les pays européens. Une nation divisée contre elle-même ne pouvait pas subsister. La double loyauté était une contradiction inadmissible dans les termes.
Pour Kallen, c’était un faux dilemme. Il y avait une différence fondamentale, selon lui, entre une « nation de nations » et une « confédération de cultures ». C’est ce dernier terme qui résume le plus précisément le statut particulier des États-Unis, un pays construit par un rassemblement de peuples. Les différentes « cultures » (aussi appelées « races » ou « ethnies » ou « nationalités ») sont les éléments constitutifs de la société civile. Chaque groupe ethnique exprimait sa vie affective et volontaire dans sa propre langue, en utilisant ses propres formes esthétiques et intellectuelles. Leurs enclaves étaient les sites de leurs relations sociales les plus intimes, les sources les plus profondes de l’identité culturelle, le domaine de la religion et de la parenté, et le terrain sur lequel le citoyen « vit, se déplace et a son être. »
L’État était une chose tout à fait différente. Il fournissait le cadre du système politique démocratique et en maintenait les règles, et ses procédures étaient convenablement menées en anglais, la lingua franca du Commonwealth. Le rôle de l’État, qui ne devait appartenir à aucune ethnie particulière, était de garantir l’existence indépendante des parties socioculturelles qui le composent. Le rôle de l’État n’était pas d’imposer l’homogénéité mais de protéger la différence. Sa devise, aurait pu dire Kallen, ne devait pas être E Pluribus Unum (De plusieurs, un), mais In Uno Plures (En un, plusieurs).
Le processus d’américanisation aurait également besoin d’une meilleure métaphore, pensait Kallen – pas le melting pot zangwillien, mais un orchestre symphonique :
Comme dans un orchestre, chaque type d’instrument a son timbre et sa tonalité spécifiques, fondés dans sa substance et sa forme ; comme chaque type a son thème et sa mélodie appropriés dans l’ensemble de la symphonie, ainsi dans la société, chaque groupe ethnique est l’instrument naturel, son esprit et sa culture sont son thème et sa mélodie, et l’harmonie et les dissonances et les discordes de tous font la symphonie de la civilisation.
L’accent de Kallen, pour être sûr, était presque complètement sur la pièce « harmonie », comme l’était celui de Zangwill ; il espérait que « ‘la civilisation américaine’ puisse en venir à signifier la perfection des harmonies coopératives de la ‘civilisation européenne’, le gaspillage, la misère et la détresse de l’Europe étant éliminés. »
Plus largement, Kallen pensait que la vision anglo-conformiste était profondément erronée en méprisant précisément ce qu’il y avait de plus remarquable dans la société multiculturelle qui avait émergé, sans planification, sur le brin américain. Et en 1915, alors que les partisans de l’américanisation gagnent en force, il semble à Kallen que le pays est à la croisée des chemins. Que voulons-nous que les États-Unis soient, demandait-il, » un unisson, chantant le vieux thème anglo-saxon « , ou » une harmonie, dans laquelle ce thème sera dominant, peut-être, parmi d’autres, mais un parmi d’autres, pas le seul ? «
L’essai de Kallen attira l’attention d’un autre titan du pragmatisme, John Dewey, qu’il avait rencontré à Cambridge en 1905 ou 1906. Kallen a entamé une correspondance avec le philosophe de Columbia, et l’a poursuivie lorsqu’il a accepté un poste d’enseignant à l’Université du Wisconsin. Kallen rend également visite à Dewey à New York. Au cours de l’été 1917, il a enseigné à Columbia sur l’invitation de Dewey, et a été invité à revenir au printemps 1918 pour donner un cours de conférences, après quoi il s’est installé à Gotham de façon permanente.
En répondant à l’essai de Kallen, à la fois dans sa correspondance personnelle et dans ses essais publics, Dewey était fortement d’accord avec une grande partie de l’analyse. « Je ne me suis jamais soucié de la métaphore du melting-pot », a-t-il dit. « Soutenir que tous les éléments constitutifs, géographiques, raciaux et culturels des États-Unis devraient être mis dans le même pot et transformés en un produit uniforme et immuable est de mauvais goût. » En effet, « le concept d’uniformité et d’unanimité dans la culture est plutôt répugnant. »
Il convenait également que la campagne d' »américanisation » était une couverture pour les anglo-supremacistes. « Je veux voir ce pays américain », écrivait Dewey à Kallen, « et cela signifie que la tradition anglaise est réduite à une souche parmi d’autres. » Dans un essai de 1916, il souligne cela, en utilisant la métaphore préférée de Kallen, en insistant sur le fait que « Ni l’Englandisme ni le NewEnglandisme, … pas plus que le Teuton ou le Slave, ne peuvent faire autre chose que de fournir une note dans une vaste symphonie. »
Dewey a également accepté que « notre unité ne peut pas être une chose homogène comme celle des États séparés d’Europe. » Le « trait d’union » devait être accueilli favorablement. « La variété est l’épice de la vie, et la richesse et l’attrait des institutions sociales dépendent de la diversité culturelle entre les unités séparées. Dans la mesure où les gens sont tous semblables, il n’y a pas d’échange entre eux. Et il est préférable de donner et de prendre ». Les États-Unis devraient extraire « de chaque peuple son bien particulier, de sorte qu’il cède à un fonds commun de sagesse et d’expérience ce qu’il a particulièrement à apporter. Toutes ces concessions et contributions, prises ensemble, créent l’esprit national de l’Amérique ». Ce n’est que dans ce sens que l’assimilation était acceptable. En effet, « une véritable assimilation les uns aux autres – et non à l’anglo-saxon – semble être essentielle pour un Américain. Que chaque section culturelle maintienne ses traditions littéraires et artistiques distinctives me semble des plus souhaitables, mais afin qu’elle puisse avoir le plus à apporter aux autres. »
Dewey avait tout de même quelques réserves sur l’argument de Kallen. D’abord, il semblait supposer que l’harmonie était l’état par défaut des relations inter-ethniques. « Je suis tout à fait d’accord avec votre idée d’orchestre », a expliqué Dewey, « mais à condition que nous obtenions vraiment une symphonie et non pas un grand nombre d’instruments différents jouant simultanément. » L’obligation civique n’était pas suffisamment soulignée dans le pluralisme de Kallen, centré comme il l’était sur les parties plutôt que sur le tout.
Le provincialisme était une deuxième préoccupation. « Ce qui est dangereux, c’est que chaque facteur s’isole, essaie de vivre de son passé, puis tente de s’imposer aux autres éléments, ou du moins se maintient intact et refuse ainsi d’accepter ce que les autres cultures ont à offrir. » Cette chaussure convenait mieux aux Anglos, c’est certain, mais toute ethnie pouvait être la proie de loyautés étroites et de préjugés de clocher.
Puis il y avait l’accent mis par Kallen sur la continuité ethnique plutôt que sur le changement. Kallen laissait entendre que les ethnies étaient virtuellement indémodables, et suggérait que les américanisateurs avaient été induits en erreur en les pensant facilement remodelables parce qu’ils se concentraient sur les externalités superficielles. Il est vrai, selon Kallen, que les nouveaux arrivants adoptent souvent l’assimilation comme stratégie économique et adoptent le langage, les vêtements et les manières américaines. Mais une fois que l’immigrant a atteint un certain niveau d’acceptation et de stabilité, l’assimilation ralentit, voire s’arrête, et les idéaux de nationalité refont surface. Le « rital se transforme en un fier Italien ; le beau gosse en un fier Slave nationaliste ». Par moments, Kallen semblait suggérer une base biologique à cette stase, avec son discours sur les « dotations ancestrales », bien qu’il ne se soit jamais vraiment aventuré sur le territoire de Madison Grant, et son accent sur la fixité pouvait être mis sur des cultures obtuses.
Un an après l’essai Nation de Kallen, une objection plus dynamique à la métaphore du melting-pot a été avancée par Randolph Bourne, une connaissance de Kallen et un disciple de Dewey. Bourne n’était pas un universitaire, mais un journaliste qui se décrivait comme un membre de la « jeune intelligentsia » de New York, mais ses relations avec le Columbia College avaient été transformatrices. Il avait eu une enfance difficile dans la banlieue de Bloomfield, dans le New Jersey, où il avait souffert de l’effondrement de la fortune familiale lors de la Panique de 1893 et de multiples handicaps physiques : ses traits avaient été gravement mutilés par un forceps à la naissance, et il avait développé un bossu à la suite d’un accès de tuberculose spinale à l’âge de 4 ans.
En 1909, Columbia lui fournit une bourse universitaire complète. Il y est initié aux écrits de James et de Boas, développe une politique socialiste en partie grâce à ses cours avec Beard, et devient un étudiant de Dewey, voyant dans son pragmatisme « un tranchant sur celui-ci qui tailladerait les habitudes de pensée, les coutumes et les institutions dans lesquelles notre société a vécu pendant des siècles. » Après avoir obtenu son diplôme en 1913, il passe un an en Europe, puis s’installe dans le Village et rejoint la scène radicale. Il obtient un poste de collaborateur au New Republic et y publie en 1915 sa série d’articles applaudissant le plan Gary. Mais se sentant marginalisé, il se tourne vers d’autres magazines pour trouver des débouchés et, en juillet 1916, il donne son « Trans-National America », une pièce inspirée par le travail de Kallen, à l’Atlantic Monthly.
« Aucun effet réverbérant de la grande guerre », court sa phrase d’ouverture, « n’a causé à l’opinion publique américaine plus de sollicitude que l’échec du « melting-pot »…. . . Nous avons dû voir de vieux brahmanes au cœur dur s’indigner vertueusement au spectacle de l’immigré refusant d’être fondu… Nous avons dû écouter des publicistes qui se disent stupéfaits par l’évidence de vigoureux mouvements traditionalistes et culturels dans ce pays chez les Allemands, les Scandinaves, les Bohémiens et les Polonais, alors que dans le même souffle ils insistent pour que l’étranger soit assimilé de force à cette tradition anglo-saxonne qu’ils qualifient sans hésitation d' »américaine ».
Avec beaucoup plus de vigueur que Kallen – aidé peut-être par le fait qu’il est lui-même de vieille souche anglaise – Bourne a déchiré l’hypocrisie anglo-américaine. La vérité est « qu’aucune nation étrangère n’a fait preuve d’une allégeance culturelle plus tenace envers la mère patrie » que les descendants anglo-saxons aux Etats-Unis. « Les snobismes anglais, la religion anglaise, les styles littéraires anglais, les révérences et canons littéraires anglais, l’éthique anglaise, les supériorités anglaises, ont été la nourriture culturelle que nous avons bue au sein de nos mères. » La guerre avait exacerbé ces sentiments, révélant que les Anglos « aiment encore les choses anglaises, font allégeance à la Kultur anglaise, sont mus par les shibboleths et les préjugés anglais. Ce n’est que parce qu’elle a été la classe dirigeante de ce pays […] que nous n’avons pas entendu parler abondamment et avec mépris d' »Anglo-Américains à trait d’union ». En vérité, l’élément anglo-saxon « est coupable de ce dont toute race dominante est coupable dans tous les pays européens : l’imposition de sa propre culture aux peuples minoritaires. »
Hélas, l’américanisation avait échoué. « Les forts mouvements culturels représentés par la presse, les écoles et les colonies étrangères » étaient en mesure de sauver les États-Unis de la stagnation culturelle, précisément parce qu’ils « n’ont pas été fondus ou réunis, transformés en un américanisme homogène. » Au contraire, le pays est devenu « une fédération cosmopolite de colonies nationales, de cultures étrangères, auxquelles l’aiguillon d’une concurrence dévastatrice a été retiré. L’Amérique est déjà la fédération mondiale en miniature, le continent où, pour la première fois dans l’histoire, a été réalisé ce miracle de l’espoir, la vie pacifique côte à côte, avec un caractère substantiellement préservé, des peuples les plus hétérogènes sous le soleil ». L’Amérique, affirmait Bourne, « est un tissu sociologique unique, et c’est faire preuve de pauvreté d’imagination que de ne pas s’enthousiasmer devant les potentialités incalculables d’une union d’hommes aussi inédite. »
Si « l’Amérique est en train de devenir, non pas une nationalité, mais une trans-nationalité, un tissage en va-et-vient, avec les autres pays, de nombreux fils de toutes tailles et de toutes couleurs », il s’ensuit, selon Bourne, que « tout mouvement qui tente de contrecarrer ce tissage, ou de teindre le tissu d’une couleur quelconque, ou de démêler les fils des brins, est faux par rapport à cette vision cosmopolite ». Le transnationalisme était l’antidote au nationalisme « belliqueux, exclusif, consanguin », « le poison dont nous sommes témoins actuellement en Europe. » C’est pourquoi il était « presque fanatiquement contre les programmes actuels de l’américanisme, avec leur préparation, leur conscription, leur impérialisme, leurs questions d’intégration, leur imitation servile des nationalismes européens qui s’entretuent sous nos yeux. »
__________________________________
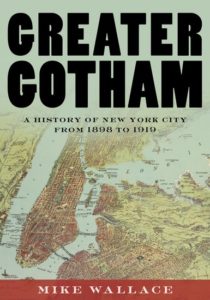
.